Historien de l’économie, penseur et témoin des bouleversements des années 1930, Karl Polanyi s’est notamment singularisé par ses réflexions sur le travail conçu comme une marchandise, processus visant à favoriser l’émergence d’une société de marché. État des lieux d’une pensée toujours d’actualité.
Le travail, la nature, la monnaie. Dans La Grande Transformation, son œuvre majeure publiée en 1944, Karl Polanyi détaille combien ces trois éléments inhérents au fonctionnement des communautés humaines ont été saisis au XIXe siècle, pour être réduits à l’état de marchandises, afin de construire une société structurée par les principes du marché autorégulé. Sa description d’un « désencastrement » de l’économie de marché par rapport à la sphère sociale, politique et démocratique, nombreux sont ceux qui estiment qu’elle pourrait valoir pour notre époque, quand Polanyi avait cru expliquer son échec et sa disparition définitive. Cette actualité, réelle ou supposée, invite à réexaminer ce qu’il nous dit du travail, de la manière dont il est saisi par les mécanismes de marché, des tensions et ruptures qui naissent d’une telle démarche, mais aussi des perspectives écologiques tracées par l’identité de destin entre travail et nature.
Remarque
Les références entre parenthèses renvoient à : Karl Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard, coll. Tel, 2009.
Le travail, marchandise fictive
« Ce n’est pas à la marchandise de décider où elle sera mise en vente, à quel usage elle servira, à quel prix il lui sera permis de changer de mains et de quelle manière elle sera consommée ou détruite. » (p. 251)
Au travers du processus historique à l’œuvre dans l’Angleterre du XIXe siècle, Karl Polanyi décrit l’émergence d’une société de marché dont l’une des caractéristiques est le traitement du travail comme une marchandise. On pourrait objecter que la chose est bien connue des juristes, qui savent que le modèle du salariat suppose une transaction fictive ayant pour objet la force de travail du salarié. Mais la problématique dépasse de très loin cet artifice juridique. Pour Polanyi, la création d’un marché du travail suppose que le travail réponde à la définition de la marchandise, à savoir « des objets produits pour la vente sur un marché » (p. 121). Le travail ainsi réifié s’inscrit dans un mécanisme de marché autorégulateur, qui fixe son prix – le salaire – au terme d’une rencontre entre offre et demande, chaque acteur poursuivant un intérêt économique propre, individualiste et rationnel.
Pour parvenir à instituer la fiction de ce marché du travail, trois conditions sont nécessaires. D’abord, la perte de statut de l’individu, qui doit en quelque sorte être atomisé, coupé de ses possibles réseaux de solidarités pour être rendu disponible au marché (p. 235) – il le sera en 1834 en Angleterre par l’abolition des lois de Speenhamland qui organisaient l’assistance aux pauvres, et en Europe continentale suite à la mise à l’écart des autorités qui régulaient l’exécution du travail, comme les corporations en France –. Ensuite, l’absence d’interférences qui, tel un salaire minimum, risqueraient de brouiller les lois économiques, considérées comme naturelles (p. 189). Enfin, bien que l’absence de règle soit théoriquement souhaitée, une intervention vigoureuse de l’État peut être rendue indispensable pour contrecarrer les résistances qui apparaissent, au premier rang desquelles l’organisation collective des travailleurs pour défendre leurs intérêts, comme dans le mouvement chartiste en Angleterre (p. 245).

Vu d’aujourd’hui, où un salaire minimum côtoie des conventions collectives et un système de sécurité sociale, la comparaison peut sembler malvenue. Il y a pourtant tout lieu de penser que certains caractères du travail marchandise décrit par Polanyi ont survécu, ou font l’objet de résurgences, dans un cadre général certes infiniment plus protecteur que celui du XIXe siècle. L’obsession de notre époque pour l’employabilité, par exemple, dit beaucoup de la manière dont les attributs affichés par les prétendants au salariat (compétences, mobilité, disponibilité, flexibilité) doivent être façonnés pour correspondre aux exigences du marché. L’idée que le travail serait « produit pour la vente sur un marché » irrigue jusqu’au système scolaire : la réforme du lycée professionnel annoncée au printemps a réactivé les débats sur le rôle de l’éducation nationale, tiraillée entre instruction des citoyens en devenir et construction des futurs travailleurs. Comme le système universitaire, le secondaire risque, à terme, d’être jugé à l’aune du taux d’insertion professionnelle.
Dans cette même optique, la politique poursuivie actuellement par le gouvernement français au travers de la loi «pour le plein-emploi » vise l’intégration sur le marché du travail des publics même les plus éloignés de l’emploi. Cette démarche ne va pas sans rappeler la période décrite par Polanyi durant laquelle s’est organisé un traitement économique et scientifique des populations paupérisées, aboutissant à une catégorisation différenciant les indigents ou inaptes, bénéficiaires d’une forme de secours (quoique profondément maltraités alors dans les institutions les accueillant), et les chômeurs forcés à travailler sous la menace, pour le bien de l’industrie (p. 307). Polanyi n’oublie pas de signaler que la marchandisation du travail implique aussi que les travailleurs soient soumis aux caprices et aléas du marché (p. 251). Cette analyse fait écho aux constats contemporains d’individus transbahutés des secteurs déclinants vers ceux survivant à la destruction créatrice, de bassins d’emplois en crise vers des territoires dynamiques, ou de professions vouées à une disparition prochaine vers les nouveaux « métiers en tension ».
Le travail, espace de résistance du corps social
« Comme le fonctionnement de ces marchés menace de détruire la société, la communauté a cherché, par une action d’autodéfense, à les empêcher de s’établir ou, une fois qu’ils ont été établis, à intervenir dans leur libre fonctionnement. » (p. 280)
Les processus profondément déshumanisants décrits dans La Grande Transformation, ont généré une série de résistances de formes et de natures très diverses, jusqu’au glissement historique que décrit La Grande Transformation au sortir des années 1930, marquées par le fascisme. Ces résistances s’expliquent par l’atteinte aux intérêts de l’être humain induite par l’expérimentation d’un marché autorégulé, la société entrant dans une logique « d’autodéfense ». Paradoxalement, Polanyi remarque que le marché du travail lui-même ne pouvait exister que si un minimum de protections étaient apportées aux travailleurs, afin qu’ils restent effectivement disponibles et permettent le fonctionnement du mécanisme (p. 195).
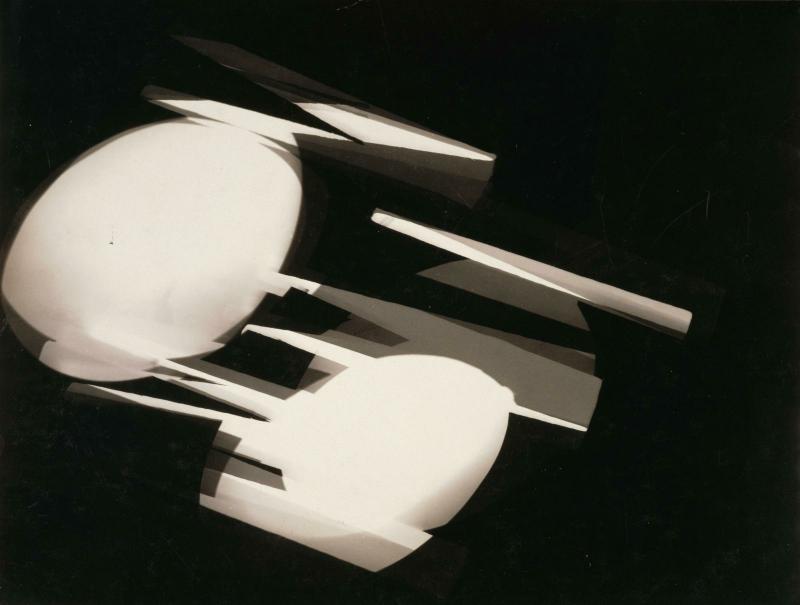
Une dialectique contre-intuitive peut s’élaborer alors, par laquelle les libéraux concèdent des lois sociales destinées à assurer le maintien de la force de travail à des conditions compatibles avec le marché autorégulateur… sans toutefois renoncer à leur projet. Car sur d’autres volets, en particulier celui de l’organisation collective, les mesures répressives traduisent le fait que le marché autorégulé a besoin d’un certain degré d’intervention, et n’est donc aucunement synonyme de « laissez-faire » (p. 204 ; p. 217). L’inéluctable émergence d’une classe ouvrière ne fait ensuite que porter la société à son point de rupture : chaque conquête sociale ne peut qu’empêcher le marché autorégulé de fonctionner selon ses mécanismes naturels, créant une série de désordres (aggravés par les spéculations des marchés financiers et le chaos monétaire) (p. 285). Ce tumulte apparaît comme fatalité dès lors que la sphère politique a elle-même théorisé sa séparation de la sphère économique, et par là son incapacité à intervenir (p. 301).
Remarque
Polanyi considère que les mouvements ouvriers du début du XXe siècle en Europe occidentale portaient moins le risque d’un basculement dans le bolchevisme inspiré par l’Union soviétique, que celui d’une paralysie totale et définitive des mécanismes de marché, à mesure que s’étendait l’interventionnisme dans la sphère sociale (p. 265).
Face à l’utopie dangereuse d’une société de marché que les libéraux avaient tenté d’instituer, Polanyi a assisté aux tensions sociales pouvant déboucher sur des alternatives progressistes aussi bien que réactionnaires, et même fascistes. Sa pensée invite à emprunter le chemin d’un « ré-encastrement » de la sphère économique dans le champ politique et social, tout en restant soucieux au premier chef de préserver la liberté des individus, acquis des sociétés libérales (p. 344). S’agissant du travail, l’auteur ne nie pas que ce ré-encastrement constitue une « transformation radicale », impliquant la détermination de caractéristiques essentielles de la relation de travail hors des mécanismes de marché (p. 340). Fidèle à sa lecture anthropologique, Polanyi insiste sur la nécessité de ne pas réduire le travail, ses mobiles et son organisation à une rationalité purement économique, qui transforme les individus en automates. On ne saurait mieux dire à l’heure où la perte de sens est largement dénoncée, qu’elle émane d’un travail trop standardisé ou fortement intensifié, d’objectifs incompréhensibles voire perçus comme néfastes, ou encore d’injonctions contradictoires.
Cette divergence entre les aspirations des salariés et les cadres de pensée des entreprises ou des décideurs économiques, qui semble s’être accentuée à la sortie de la crise du Covid-19, constitue peut-être une chance : elle démontre que le travail reste un espace où s’expriment des visions du monde, des rationalités et des croyances partagées qui peuvent différer de la rationalité économique. Dans une perspective polanyienne, des institutions – on pense en premier lieu aux syndicats, dont il loue la fonction morale et culturelle (p. 315) – doivent combiner ces inclinaisons avec leurs revendications plus classiques comme la question salariale. L’agenda de l’exécutif français, axée sur le « partage de la valeur » et laissant dans l’angle mort le partage de la prise de décision, en dit long sur ses réticences à accepter d’autres principes d’action que l’enrôlement dans la compétition et la rationalité économique. L’autodéfense évoquée par Polanyi peut aussi, pour se conjuguer avec l’impératif de liberté, prendre la forme d’une réappropriation de la chose économique au travers des modèles de l’économie sociale et solidaire, afin de participer à l’édification d’un système économique démocratique et pluraliste, dont tous les acteurs n’obéissent pas aux seules logiques du profit.
Remarque
En ce sens, il n’est pas étonnant de lire les développements que Polanyi consacre aux réflexions de Robert Owen, pionnier de la pensée coopérative (p. 191 et s. ; p. 240 et s.).
Le travail, indissociable de la nature
«On ne peut pas séparer nettement les dangers qui menacent l’homme de ceux qui menacent la nature. » (p. 268)
Le Karl Polanyi de La Grande Transformation peut-il contribuer à tracer des perspectives écologistes ? La question mérite que l’on s’y arrête, en prenant toutefois certaines précautions. Car Polanyi n’envisage évidemment pas « la terre » ou « la nature », soumises elles aussi à la logique de marché autorégulateur, avec l’inquiétude que l’on partage désormais. Il met en lumière les effets du mouvement des « enclosures » en Angleterre, qui par l’introduction d’une propriété privée des terres ont permis une marchandisation du sol, l’émergence un marché des matières premières et des denrées, et la disponibilité de la future population ouvrière (p. 76 et s.). Les effets délétères induits au XIXe siècle étaient liés à l’émergence d’une interdépendance internationale (désorganisations de la production, spéculations sur des aliments de base, politiques coloniales) (p. 257). C’est peu dire que sur ce front, les problèmes n’ont fait que s’accentuer, la surexploitation continue des milieux naturels et les marchés mondiaux de matières premières conduisant à une situation d’urgence qui était encore inimaginable en 1944. D’où, aussi, l’apparition de résistances du corps social face au désastre annoncé.

Polanyi relie la nature au travail en soulignant que « la main d’œuvre et la terre ne sont pas séparées » (p. 253). Car les conditions d’existence de la force de travail sont liées aux fonctions qu’il qualifie de « vitales » de la terre, et qui dépassent de loin sa fonction économique : stabilité de vie, habitat, sécurité matérielle, paysages ou saisons – on serait tenté d’ajouter « climat » –. Dit autrement, l’être humain travailleur s’inscrit dans son environnement, et le travail en tant que tel est une forme d’appréhension de cet environnement. Réinstituer la dimension sociale du rapport à la nature et l’extraire des lois de l’économie revient donc là aussi à penser hors de l’intérêt individuel, dans un cadre nouveau et plus large. Dans l’organisation productive, la maximisation du gain laisse alors une place aux autres formes d’intégration économique que sont la réciprocité ou la redistribution, lesquelles imposent des formes de solidarité et de décisions collectives bien plus en phase avec la préservation de l’environnement.
Les réponses face à la marchandisation de la terre ne sont peut-être pas si éloignées de celles envisagées pour le travail : Polanyi invite à intégrer la nature dans diverses institutions (citant notamment la coopérative, la commune ou les réserves naturelles) (p. 340), ce qui n’a de sens qu’en concevant leur fonctionnement sur des bases solidaires et démocratiques, et à des échelles locales. La théorie des « biens communs » constitue alors une voie cohérente, entre marché et étatisation, pour faire naître ces institutions permettant d’inscrire aussi bien les populations que leur écosystème dans le temps long. Car c’est au fond le défi auquel nous invite encore aujourd’hui Polanyi : face au risque de destruction que court notre planète, c’est à la pluralité des interactions humaines et des relations à l’environnement qu’il convient de revenir, laissant le marché à sa juste place pour construire l’hypothèse d’une société qui «peut se permettre d’être à la fois juste et libre » (p. 346).